Flash info
Nouveau site Internet
Ce site n'est plus mis à jour.
Vous pouvez désormais consulter notre nouveau site !
Affinités sélectives, Zoom sur Jeunesse

Créé le:

Le choix de l’anglais nous a semblé intéressant pour aborder la lecture d'album. Il s'agit de souligner ainsi que l’apprentissage d’une langue est aussi un vecteur de découverte, de plaisirs et d’ouverture culturelle. A une époque où l’anglais est un passage obligé pour tous les écoliers, il est bon de rappeler que ce n’est pas seulement la langue des affaires ou de l’économie mais aussi la langue d’une littérature et d’une culture.
Ce choix s’explique d’autant plus par la qualité et la richesse de la production éditoriale jeunesse dans cette langue. La littérature de jeunesse anglo-saxonne relève d’une tradition plus ancienne qu’en France. La première maison d’édition pour la jeunesse ouvre à Londres dès 1744 ! On peut considérer qu’elle est à la fois mieux assumée, et moins confinée à un public exclusivement enfantin. Mieux assumée, parce que le statut d’auteur pour la jeunesse ne soulève pas les mêmes considérations qui ont longtemps agité – et agitent toujours – le monde du livre pour enfants en France (s’agirait-il d’un sous-genre ? de sous-auteur ? d’une sous-littérature, plus facile, moins exigeante ?). Cette littérature, devenue patrimoniale, ne se limite pas à un lectorat d’enfants et de jeunes. De nombreux auteurs trouvent leur public parmi plusieurs générations, en proposant des œuvres exigeantes dont le niveau littéraire n’a rien à envier à la littérature destinée aux adultes.
Dès le 19e siècle, des œuvres telles qu'Alice in Wonderland de Lewis Carroll ou Winnie the Pooh de Alan Alexander Milne montrent combien la littérature de jeunesse peut être riche et comporter de nombreux niveaux de lecture, allant de la simple histoire divertissante à un travail complexe sur la langue, le mot, le sens.
Cette littérature de jeunesse se caractérise donc par des univers d’auteurs/illustrateurs très singuliers (Maurice Sendak, Chris Van Allsburg, Anthony Browne…), qui font la part belle à l’onirisme, à la poésie, mais aussi à l’excès et à la volubilité, tant de l’image que du texte, et à cet humour si décalé, parfois subversif, qui bascule bien souvent dans un « nonsense » typiquement britannique. Les albums sélectionnés témoignent pour une grande partie de cet esprit décalé et montrent combien l’univers de tout un chacun (enfant, adolescent ou adulte) peut s’enrichir à la rencontre de ces lectures.
Il est préférable d’être deux : une personne lisant le texte en langue française et une personne lisant le texte en langue originale. Le lecteur lisant la langue originale devra en avoir une bonne maîtrise pour faire entendre la musicalité de la langue et dans ce cas, de la langue anglaise. La phonétique doit être respectée pour inviter l’enfant à reproduire le son sur le mode de l’imitation.
Si l’on s’inspire du principe des films en version originale, il sera judicieux de lire en un premier temps la version originale puis en second temps la version française. Il est souhaitable de lire successivement une page après l’autre en langue originale puis en langue française pour permettre le repérage des mots connus dans la phrase ou le sens global de la phrase.
Un entraînement préalable est nécessaire car les deux lecteurs doivent lire en alternance et permettre aux auditeurs-spectateurs d’observer chaque page. Il s'agit d'écouter un texte, une narration mais aussi de découvrir une œuvre graphique, des images qui ajoutent un supplément de sens et un supplément d’âme au récit. Un album est une entité et ne peut être envisagé sans les images.
Goblin market (Marché gobelin), à lire à voix haute pour le plaisir de savourer la musicalité de ce texte , extrait de Goblin market and other poems de Christina Rosetti , femme poète du 19ème siècle proche des Préraphaélites. Une histoire de gobelins subversifs qui ne laisse pas indifférent, magnifiquement illustrée dans la version française parue chez MeMo.
Dans un souci d’ouverture culturelle, il est intéressant d’organiser ces lectures bilingues dans des lieux tels que la bibliothèque, le centre de loisirs, l’école, en y incluant les collèges, voire les lycées, car une majeure partie de ces albums s’adressent à tous.
Les familles d’origine étrangère ont intérêt à être associées pour des lectures qui deviennent des moments d’échange. On peut aussi organiser ces lectures dans une maison de quartier, un centre social, avec une association liée à une communauté linguistique ou une école internationale. Cela permet de centrer le projet sur la découverte des cultures en offrant la possibilité à des personnes qui parlent une autre langue que le français de transmettre leur compétence, de partager leur culture.
Des étudiants en langue, des jeunes collégiens, lycéens parlant une langue étrangère peuvent s’impliquer pour animer ces lectures bilingues en direction des enfants.
En 2013-2014, la langue espagnole sera mise en valeur.
Les albums sélectionnés pour ces valises témoignent de la richesse de la production éditoriale de langue anglaise : auteurs et illustrateurs incontournables, contes et comptines traditionnels pour les plus petits, classiques et albums plus contemporains pour tous…
Ils mettent également en avant le talent d’artistes phares, qui sont à la fois auteur et illustrateur (Maurice Sendak, Anthony Browne…), ou encore l’inscription dans le patrimoine de la littérature de jeunesse de duos célèbres (Quentin Blake / Roald Dahl ou Michael Rosen, Jeanne Willis / Tony Ross…).
Enfin, ils soulignent la richesse des passerelles culturelles entre la France et les pays anglo-saxons, avec des auteurs qui traversent la Manche ou l’Atlantique pour livrer leur univers dans plusieurs langues (Tomi Ungerer).
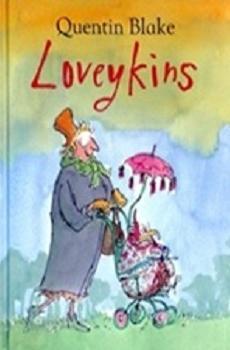
Quentin Blake est un grand dessinateur qui travaille avec de nombreux auteurs, quand il n’écrit pas lui même ses textes. Ses illustrations, si reconnaissables, se caractérisent par des touches d’aquarelles soulignées d’un trait au crayon noir qui tracent en réalité les contours tout en finesse des personnages et des décors qu’il fait naître. L’humour caractérise ses dessins mais aussi une expressivité profondément touchante comme dans Michael Rosen’s Sad Book.
Dans Petit Chou (Loveykins), Quentin Blake est à la fois illustrateur et auteur. L’album raconte l’histoire d’une femme qui trouve un oiseau et l’élève comme si c’était son enfant. On y retrouve toute l’exubérance de Blake, à la fois dans le récit (tout est trop grand dans cette histoire, à commencer par l’oiseau gavé de confiseries, obligé de déménager dans un abri de jardin, dont il ressortira, énorme et dodu, après que celui-ci s’est écroulé au cours d’une tempête non moins impressionnante) et dans les illustrations, aux couleurs chatoyantes (Blake joue notamment sur les imprimés des vêtements) et aux personnages farfelus, à commencer par « Petit chou » lui-même, avec ses deux grands yeux écarquillés, dont Blake affuble tous ses personnages mais qui ici lui donnent un air particulièrement interloqué !
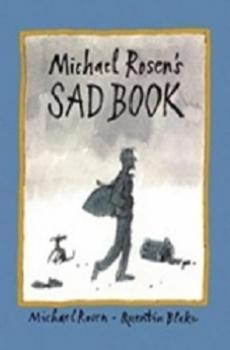
Changement de ton radical avec Quand je suis triste (Michael Rosen’s Sad Book) : ici, les aquarelles de Quentin Blake se mettent au service de la plume de Michael Rosen, autre auteur pour la jeunesse, qui livre avec cet album un récit autobiographique sombre mais bouleversant sur le deuil. Les illustrations, tout en subtilité, captent l’essence du texte et jouent sur les gris et les notes de couleur pour dire la douleur et la nécessité de continuer à vivre. Comment ne pas citer, enfin, La collaboration fructueuse de Quentin Blake avec le grand écrivain Roald Dahl, duo prolifique et plein d’humour pour la réalisation de L’Enorme Crodocile (The Enormous Crocodile).
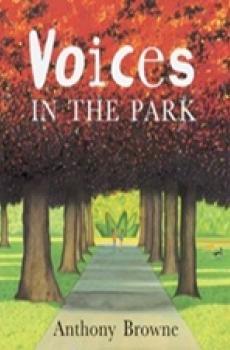
Anthony Browne est l’un des artistes de littérature pour la jeunesse les plus célébrés à travers le monde. Il a obtenu le Prix Hans Christian Andersen en 2000 pour l’ensemble de son œuvre.
Lire des albums d’Anthony Browne, c’est donner au lecteur l’occasion de trouver le sens profond de l’histoire en décodant les images qui donnent un supplément de sens au récit. Quelque soit le bagage culturel du lecteur, enfant, adolescent ou adulte, quand on regarde une image d’Anthony Browne, il se produit une véritable jubilation : selon le cas, le singe, image récurrente dans son œuvre renvoie tantôt au père protecteur et costaud que Browne a perdu prématurément, il peut aussi évoquer King Kong ou la part d’animalité de notre humanité.
La référence aux œuvres d’art est sa marque de fabrique (surréalisme, symbolisme, cinéma,..). Browne détourne de nombreux symboles iconiques, les classiques de la peinture sont revisités avec humour (Les tableaux de Marcel). Browne a l’art de mettre en image des états d’âme et fantasmes, la relation entre les êtres au sein de la famille par le biais d’images qui renvoient à un imaginaire puissant.
Il s’agit d’une même histoire vécue dans un parc public par quatre personnages différents. A chaque saison correspond l’état d’âme d’un personnage : la mère bourgeoise évolue dans un paysage automnal dans des tonalités de rouges et d’ocre, symboles d’opulence. Cette saison peut être aussi l’emblème d’un certain état dépressif dont la mère serait victime. Le père chômeur évolue dans un hiver à la fois rude (le père Noël noir fait la manche, la Joconde et le Cavalier se morfondent dans leur cadre) et heureux : la fille de ce père malheureux vient éclairer sa vie et le père Noël se met à danser ainsi que la Joconde et le Cavalier sortis de leur tableau, le triste lampadaire se transforme en perce-neige). La pétillante fille du chômeur se situe dans un été flamboyant où les arbres sont de gros fruits, le garçonnet, quant à lui, se situe dans la saison de l’entre-deux à savoir le printemps qui correspond tantôt à la grisaille/tristesse tantôt à la lumière/ joie de vivre.
Dans ce récit, le registre de langue et la typographie sont à examiner avec attention, ils donnent de la densité aux personnages. Cette histoire emblématique de l’œuvre de Browne est riche d’une telle polysémie qu’elle permet des relectures infinies...
C’est une histoire de métamorphose. En témoigne le nom du jeune garçon qui s’appelle Joseph K, comme le héros de Kafka. Ce fils unique va vivre un changement, une multitude d’indices iconiques le signifient au lecteur : l’arrivée d’un bébé au sein de sa maison.
Le lecteur est plongé dans l’imaginaire du garçon, de l’auteur qui met en image les fantasmes, les symboles qui les hantent. L’inconscient n’est pas loin. Une lecture freudienne voire lacanienne de cet album est possible (les symboles phalliques et symboles liés à la naissance sont nombreux, la chambre lieu de la conception est évoquée par la porte noire,…).
L’étrangeté est au rendez-vous : le tableau d’E.T. dans la chambre de Van Gogh, le canapé crocodile, le balai hérisson. L’univers de Magritte est clairement signifié pour dire la confusion et le mystère qui planent dans l’esprit du garçon.
Un père et ses deux fils se comportent comme des cochons à la maison en laissant la mère de famille (représentée sans visage) s’épuiser à assumer toutes les taches ménagères et à nettoyer derrière eux…Leur méfait les caractérisant à tel point, ces trois personnages mâles se transforment alors en cochons, comme dans le récit d’Ulysse sur l’île de Circé... La mère disparue, les trois sagouins sont livrés à eux mêmes et déplorent son départ. Elle réapparaîtra avec un visage souriant quand les hommes auront compris qu’ils doivent changer d’attitude, ceux-ci reprenant alors une figure humaine. Une fable féministe à l’humour décapant !
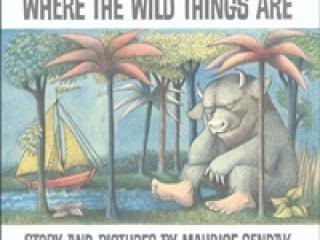
Maurice Sendak est un des rares auteurs pour la jeunesse mondialement connu auquel la presse internationale a rendu hommage suite à sa disparition en mai 2012.
En 1970, il est couronné par le prix Hans Christian Andersen, le « Nobel » du livre pour enfants. Cet Américain, né en 1928 de parents juifs polonais, s’est fait connaître par un livre qui a choqué l’opinion publique lors de sa parution en 1963 : Where the wild things are (Max et les maximonstres).
Sendak met en scène des enfants qui ont du cran, des enfants qui font face à des situations bouleversantes et aventureuses, loin de l’image doucereuse et traditionnelle de l’enfance. Les albums de Sendak ont la particularité d’être théâtral, la pagination, la progression du récit s’organisent autour de ce propos et le livre se lit comme une pièce de théâtre, le théâtre de la vie...
En parallèle de son activité d’auteur, Sendak a conçu le décor de nombreux opéras et ballets. En 2003 il réalisa, avec le dramaturge Tony Kushner, une nouvelle adaptation de Brundibar, opéra pour enfants du compositeur tchèque Hans Krasa qui fut interprété en 1943 par des enfants déportés en camp de concentration. L’œuvre de Sendak est à découvrir de toute urgence : une œuvre dense, profonde, nourrie autant de culture européenne et germanique que de culture américaine (cf. Mickey dans Cuisine de nuit).
Cet album emblématique renvoie à la part sauvage enfouie, inconsciente du tout-petit. Un livre qui tord le cou aux tabous pour donner forme au rêve et à la peur. Certains psychologues, bibliothécaires et autres spécialistes l’ont à l’époque décrié. Il est devenu aujourd’hui un classique. Il met en scène Max, un enfant terrible déguisé en loup qui se fait punir par sa mère et l’envoie au lit sans dîner. Une forêt exotique pousse alors dans la chambre de Max dont la fenêtre ouverte sur une nuit de pleine lune laisse augurer la pantomime à venir. Max pénètre alors dans l’univers de l’imaginaire. Il embarque pour une épopée nocturne aux pays des maximonstres qui se terminera par le retour / réveil dans sa chambre où l’attend son dîner « tout chaud ». Ce livre a été adapté au cinéma par Spike Jonze en 2009.
Cet album est traduit en français par le poète Bernard Noël. Nous sommes donc là face à une œuvre littéraire pour la jeunesse : une histoire illustrée au caractère mystérieux. Le titre anglais Outside over there qui veut dire « ici là-bas » donne davantage d’indices : ici, c’est l’univers d’Ida, la grande sœur qui vit avec sa mère et sa petite sœur, bébé. Là-bas, c’est l’univers du père, parti au loin sur un navire mais qui garde une présence tutélaire.
Le format à l’italienne de cet album donne de l’ampleur à ce récit qui se déploie horizontalement pour figurer l’ici, l’ailleurs maritime et le cheminement. Alors que la mère reste perdue dans ses pensées, Ida a la garde du bébé et joue en même temps du cor de chasse tandis que des lutins malfaisants (des gobelins en anglais) emportent le bébé par la fenêtre laissée ouverte et laissent un substitut de glace qui fond lorsqu’Ida le prend dans ses bras. Ida la combattive revêt alors la cape maternelle, emporte son cor et s’engage à rebours par la fenêtre. S’ensuit un périple lisible à deux niveaux : Ida évoluant dans les nuées tandis qu’en contre bas le bébé est emporté dans un univers de grotte et d’eau, qui peut symboliser le monde intra-utérin. Au final, Ida (cf. héroïne de Verdi ) parvient à envouter les lutins grâce au pouvoir de sa musique et a délivrer sa sœur pour la ramener auprès de sa mère qui l’attend joyeuse pour lui lire la lettre du père.
Le texte musical se lit comme un livret d’opéra, les images mettent en lumière de multiples clins d’œil à la musique germanique principalement. Ceci confère à ce récit une polysémie et une densité extraordinaire nourris de correspondances visuelles et sonores : « le Vaisseau fantôme » de Wagner, les ballades de Schubert liées à des pastorales (cf. les bergers alanguis veillant sur de paisibles moutons) , les gigues endiablées et les sonates de Mozart qui apaisent quand surviennent l’accalmie et le retour à la maison. La jeune mère, telle une digne héroïne d’un roman de Goethe, lit la lettre du père à sa grande fille dont les larges pieds nus gardent une belle emprise dans la terre. Telle peut être une des propositions de lecture de cet album magistral !
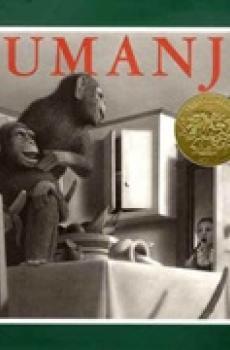
Né en 1948, Chris Van Allsburg est un grand auteur, illustrateur américain de livre pour enfants. Il fut récompensé de la médaille Caldecott à deux reprises, pour ses livres Jumanji (1982) et Boréal-express (1985), qu'il écrivit et illustra et qui furent adaptés au cinéma. Il reçut par ailleurs la médaille Caldecott d'honneur en 1980 pour son livre Le Jardin d’Abdul Gasazi(source Wikipédia).
Van Allsburg est un artiste talentueux de tendance hyperréaliste. L’épave du zéphir est en nette résonance avec l’œuvre du peintre Edward Hopper. Ses récits se situent dans le genre du fantastique.
L’histoire de Jumanji démarre banalement : les parents partent à l’opéra, les enfants restent seuls à la maison et ont pour consigne de ne pas mettre la maison sens dessus dessous. Ils partent jouer dehors et découvrent une boîte de jeu intitulée «Jumanji, un jeu d’aventures dans la jungle». Rentrés à la maison, ils commencent à jouer en se conformant aux consignes, c’est alors que l’univers du jeu envahit progressivement leur quotidien : un lion émerge sur le piano, puis des singes envahissent la cuisine…Les illustrations en noir et blanc sont d’une grande force, le cadrage est cinématographique (plongée, contre plongée,…). L’univers fictionnel prend le pas sur le réel. Quand les adultes reviennent tout redevient normal en apparence car seuls les enfants sont en mesure d’appréhender l’imaginaire...
Boréal-express (The polar express) fonctionne sur le même principe, l’histoire du train qui conduit les enfants vers le pays du Père Noël ne peut être vécue par un adulte, seuls les enfants sont en mesure de la vivre et d’entendre encore le son de la clochette du traîneau. Croire en la fiction n’est pas donné à tout le monde, tel semble être le message de Van Allsburg.
La relève est assurée
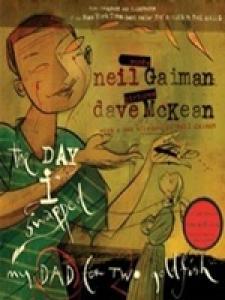
Dans Le Jour où j’ai échangé mon père contre deux poissons rouges (The Day I Swapped My Dad For Two Goldfish), Neil Gaiman, auteur britannique, notamment de romans pour la jeunesse (on peut citer Coraline, adapté au cinéma, ou encore L’Etrange vie de Nobody Owens), s’associe à Dave McKean, illustrateur (de comics notamment), photographe et graphiste, pour transposer son univers à la frontière du fantastique, du gothique et du surréalisme.
Il est question dans cet album d’un garçon qui, après avoir échangé son père contre des poissons rouges, se voit dénoncé par sa petite sœur et reçoit l’ordre de procéder à l’échange inverse, seulement… d’échanges en échanges et de maison en maison, ses camarades se sont troqués ce pauvre père-objet, et il faudra plus d’une transaction pour le ramener à la maison !) L’histoire, loufoque, est complétée par un univers graphique hors du commun, où se côtoient peinture, crayonnés, photographies, collages et un texte pleinement intégré aux illustrations, à la limite du roman graphique (réparti entre inscription dans l’image et phylactères de bande dessinée).
Cet album témoigne de la richesse de la production de ces deux auteurs aux multiples facettes, qui ne se cantonnent ici à aucun genre et livrent ainsi une œuvre pour le moins originale.
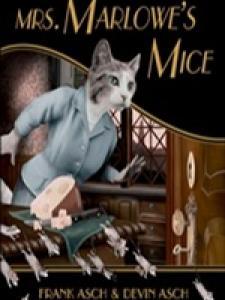
Avec Vite, cachez-vous ! (Mrs Marlowe’s Mice), Frank et Devin Asch, duo père-fils américain, racontent l’histoire d’une jeune chatte qui cache des souris dans son appartement alors même que la cohabitation des deux espèces est réprimée par le «service de la Sûreté féline» et que les souris sont traquées.
Les illustrations, réalisées à l’ordinateur, donnent à l’histoire un charme désuet, tandis que le récit, tout en subtilité, permet d’évoquer de façon détournée une traque autrement plus sombre. Les auteurs reprennent d’ailleurs une métaphore qui a déjà fait ses preuves : celle de la souris traquée et du peuple félin oppresseur, qui rappellera aux plus âgés la BD Maus d’Art Spiegelman.
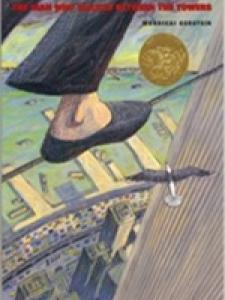
Tour à tour sur un fil (The Man Who Walked Between The Towers), relate l’histoire vraie de Philippe Petit, funambule français qui traversa sur un fil, en 1974, l’espace qui reliait les tours jumelles du World Trade Center. Mordicai Gerstein fait de cette histoire un récit à la fois émerveillé, poétique et nostalgique. Une belle façon d’évoquer cet exploit et de faire revivre les tours disparues.
L’album reçut en 2004 la médaille Caldecott, et Mordicai Gerstein déclara dans son discours de réception : « […] Books take us to places we will never go, and let us be people and creatures we can never be. Les livres nous emportent dans des lieux où nous n’iront jamais, et nous permettent de devenir des personnes et des créatures que nous ne pourrons jamais être. »